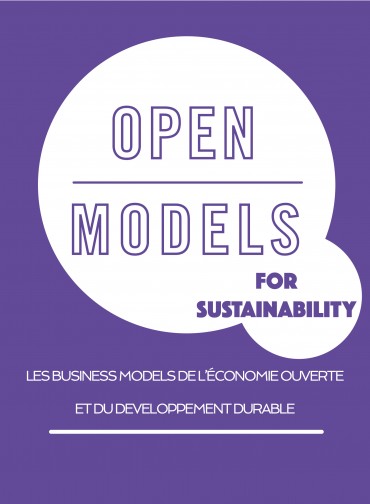Il est urgent d’imaginer de nouveaux modèles, qui seraient à la fois économiques et écologiques, véritablement biomimétiques, qui permettraient d’entreprendre sans détruire. Ce nouveau paradigme économique prendrait en compte l’ensemble des relations existantes entre des acteurs qui ne seraient donc pas uniquement des êtres humains, afin de faciliter leur coopération.
Sans surprise, la 21e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), qui s’est tenue à Paris en décembre 2015, a de nouveau mis en scène le récit rédempteur de la guerre contre le carbone. Oui, nous dit-on, le salut viendra d’une éradication des combustibles fossiles, véritables « ennemis du climat et de l’humanité ». Las, pour certains experts, peut-être plus lucides ou plus pessimistes que les autres, cet objectif demeure le rêve éveillé de quelques-uns, et n’a que peu de chance de correspondre à la réalité. S’ils ont raison, même les déjà catastrophiques +2°C de réchauffement planétaire, décrits par le GIEC comme le seuil de sécurité de la dernière chance pour la civilisation, seraient alors vraisemblablement franchis au cours du siècle.
Une fois le rideau de la conférence tombé, le grand théâtre politique continue dans les coulisses, imperturbable : le mirage d’une transition énergétique qui s’opérerait sans transformer au passage en profondeur les modes de vie, l’illusion d’un avenir de toute-puissance rendu possible grâce à des « technothaumaturgies » improbables comme la surgénération ou la fusion nucléaires, continuent à figurer dans les stratégies officieuses des gouvernements des pays les plus riches. Pourtant, dans les faits, nous n’arrivons pas à dérouler d’autre scénario que le fatal business as usual, et nous faisons nôtre l’idée que, finalement, il vaut mieux s’adapter à la catastrophe que lui faire face. La pensée technicienne et industrielle du 19e siècle, toujours bien vivante, semble avoir perdu la raison… Vraiment ?
Les mailles d’un filet psychologique
Nous sommes en réalité pris dans les mailles d’un filet psychologique et culturel qui nous empêche de questionner des présupposés, désormais invisibles aux yeux les plus exercés. Prenons la classique présentation du développement durable comme un équilibre entre les contraintes économiques, sociales et environnementales. Ce modèle dit « des trois piliers » semble séduisant et consensuel, mais c’est en réalité une fiction, car ces trois contraintes sont étroitement liées : l’économie est contrainte par la société, qui elle-même est contrainte par l’environnement. Un équilibre est impossible à atteindre dans une telle hiérarchie de contraintes, sauf bien sûr à considérer, avec l’idéologie libérale, que l’économie doit s’extraire de sa dépendance à la société, et avec l’idéologie techno-industrielle, que la société doit s’extraire de sa dépendance à l’environnement. Voici donc le programme politique jamais clairement explicité, et pourtant bien présent dans la conception conventionnelle du développement durable. Soudain, tout devient plus clair.
En effet, depuis ses origines au 18e siècle en Europe, le système techno-industriel n’a eu de cesse de détacher l’être humain de ses symbioses ancestrales, en proclamant leur dépassement définitif, comme dans le cas du cheval et de l’automobile. On pourrait donc dire qu’à la Grande transformation maintenant presque achevée, visant à remplacer les ressources sociales par le marché (c’est-à-dire à opérer la marchandisation de la société), répond la Grande substitution toujours en cours, visant à remplacer les ressources naturelles par l’industrie (c’est-à-dire à opérer l’artificialisation de la nature). Cette substitution constitue la phase ultime du processus de réquisition de la nature et des êtres humains qui en font partie, au service de la production industrielle, qui passe ainsi du statut de moyen à celui de fin dernière, au bénéfice de ceux qui tirent de cette production un profit direct. Or c’est l’activité du système techno-industriel lui-même, fortement encouragée par un système financier court-termiste, qui entraîne actuellement le dépassement des limites écologiques de la planète et menace la civilisation. Ce dépassement se traduit par une intoxication progressive des milieux et donc des êtres vivants, une perte historique de biodiversité diminuant fortement la résilience des écosystèmes, la chute drastique des effectifs des populations animales et végétales, et aboutit in fine à la dégradation des mécanismes biophysiques qui pourraient pourtant lutter efficacement contre les conséquences de ce dépassement.
La nature, notre plus puissante alliée
Que fait donc le système techno-industriel quand il est mis face à un défi comme le réchauffement climatique, qui menace son existence même ? Il poursuit sa logique implacable : pour combattre le réchauffement, il faut impérativement se débarrasser du carbone atmosphérique, pourtant fabuleuse ressource pour le monde vivant car parfaitement assimilable par la biosphère, si nous la laissions seulement se développer au maximum de ses potentialités, c’est-à-dire si nous acceptions de partager avec elle le territoire planétaire au lieu de l’en exclure progressivement. Des modèles ont prouvé la justesse de l’approche : si nous favorisions le développement des écosystèmes (océans, forêts, sols cultivés, etc.) ces alliances complexes d’espèces qui stockent le carbone atmosphérique en quantité colossales, combattre le réchauffement climatique pourrait se résumer à laisser la nature faire son patient travail. Qui d’entre nous n’a rêvé un jour de voir reverdir les déserts ? Cela pourrait pourtant se produire si nous nous en donnions les moyens, et que nous considérions enfin la nature comme notre plus puissante alliée.
De cette conclusion pleine d’espoir et d’humilité, il n’est que pourtant peu question dans les discours politiques, même si l’UICN puis la Commission européenne en ont apparemment fait un axe majeur de leur stratégie, résumé par la notion peu précise de nature-based solutions. Face aux enjeux titanesques du stockage du carbone atmosphérique, il semble bien que seule la biosphère soit capable d’opérer la restauration complète des conditions environnementales qui ont permis l’émergence de notre civilisation. Ce processus naturel, ancré dans les écosystèmes, pourrait être facilité par de nombreux outils et méthodes humaines, notamment la modification des pratiques agricoles afin de favoriser la fixation de carbone dans les sols, le développement des cultures marines en vue de pallier au manque de surfaces disponibles à terre, l’incorporation de biochar dans de nombreux produits, depuis les vêtements jusqu’aux bâtiments, etc.
De nouveaux modèles, économiques et écologiques
Et pourtant, malgré les bonnes intentions, ces approches ne se développent que très lentement, car elles reposent sur des fondations fragiles. Les tentatives de mise en place de systèmes de paiement pour les services rendus par les écosystèmes, s’appuyant en général sur des mécanismes de marché, présentent des bilans en demi-teinte. Comment pourrait-il en être autrement alors que les principes qui régissent notre économie valorisent uniquement le travail des êtres humains ? À cette aune, l’ensemble des processus biophysiques et des êtres non-humains qui composent la nature sont a-économiques, car nous ne comptabilisons leur travail nul part : ni en termes physiques, ni en termes biologiques, ni en termes écosystémiques. Et puisque la nature travaille en apparence gratuitement, elle rentre en concurrence directe avec les coûts importants du système techno-industriel, qui ne devient alors véritablement rentable pour l’investisseur que lorsqu’un acteur parvient à se débarrasser de la concurrence de la nature et à établir fermement un monopole. Ainsi, après avoir favorisé l’usage des pesticides à grande échelle et inventé des organismes génétiquement modifiés stériles, dans le but de s’arroger une large part des revenus de la production agricole, la société Monsanto, en réponse au déclin dramatique des populations d’insectes pollinisateurs, cherche à mettre au point une abeille transgénique résistante aux pesticides, promise à un marché gigantesque puisque la concurrence de la pollinisation naturelle est désormais fortement affaiblie.
Des néo-écosystèmes manufacturés, est-ce bien le monde dans lequel nous souhaitons vivre ? Il est urgent d’imaginer de nouveaux modèles, qui seraient à la fois économiques et écologiques, véritablement biomimétiques, qui permettraient d’entreprendre sans détruire. Ce nouveau paradigme économique prendrait en compte l’ensemble des relations existantes entre des acteurs qui ne seraient donc pas uniquement des êtres humains, afin de faciliter leur coopération. La métamorphose des anciens modèles, hérités du 19e siècle, fondés sur la production de biens et de services, en de nouveaux modèles fondés sur la garantie de fonctionnalités, soutiendrait évidemment une telle approche. Alors même que certains finissent par ne plus concevoir la nature autrement que d’un point de vue utilitariste, imaginons un instant les milliards de milliards d’individus non-humains peuplant la planète, tous les jours à la manœuvre dans les soutes du vaisseau spatial Terre afin de le faire fonctionner le mieux possible, tandis que les passagers humains des ponts supérieurs se querellent tout en s’acharnant à retirer un à un les rivets de la coque… Ne serait-il pas temps de coopérer avec ces myriades d’autres, tout en nous demandant à quoi pourrions-nous être utiles, à notre tour ?
Source : blog de David Bourguignon
Crédit photo : Vélizy-Villacoublay, ville biomimétique