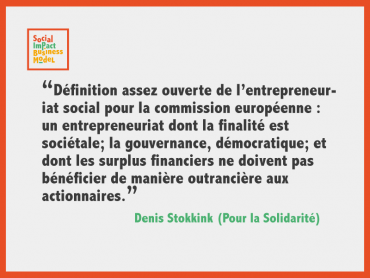Jean-Marc Borello a fondé et dirige le Groupe SOS, acteur majeur de l’entrepreneuriat social en France. A l’occasion de la sortie de son dernier livre « Pour un capitalisme d’intérêt général » il nous présente ce nouveau modèle économique qui allie l’efficacité entrepreneuriale et la prise en compte du bien commun.
Cet article est publié dans le cadre de la recherche social impact business model.
Dans votre livre vous décrivez un nouveau modèle économique, le capitalisme d’intérêt général, en quoi consiste-t-il ?
Cette proposition part d’un constat. Les entreprises, l’Etat et les associations sont en crise, pour des raisons différentes : financiarisation, baisse des ressources, incompétence. Dans le même temps, les besoins d’intérêt général sont toujours là et sont même plus importants.
Nous avons donc besoin d’organisations qui prennent en charge l’intérêt général, le capitalisme d’intérêt général est une solution.
Avant c’était le choix statutaire qui définissait la relation à l’intérêt général et selon qu’on soit une entreprise, une association ou une coopérative la relation à l’intérêt général était différente. Les entreprises commerciales ont pour objectif la satisfaction des actionnaires par la distribution de dividendes, pas l’intérêt général. C’est dans le statut même de ces organisations, ce qui peut conduire à des situations absurdes. Par exemple, en cas de difficulté, on reprochera à un dirigeant d’avoir privilégié l’emploi sur la satisfaction des actionnaires ou des fournisseurs. Les coopératives ont pour but premier de satisfaire leurs sociétaires, ce qui les éloigne de l’intérêt général pour se concentrer sur des intérêts particuliers. Les associations quant à elles ont été souvent assimilées à l’intérêt général, c’est faux. La qualité d’intérêt général est accordée par l’Etat via les préfets, elle n’est pas native dans le statut. Certaines associations sont reconnues d’intérêt général et d’autres pas.
Le capitalisme d’intérêt général c’est utiliser les outils du capitalisme en leur donnant une finalité d’intérêt général. Les entreprises d’intérêt général doivent répondre à des problèmes de société peu ou pas pourvus et prendre le meilleur de l’Etat et de l’entreprise : la prise en compte du bien commun et l’efficacité entrepreneuriale. Il s’agit bien d’une entreprise, avec des clients, des salariés, des actionnaires, elle peut même être lucrative. Mais c’est une entreprise qui poursuit trois types d’objectifs qui ont la même importance : économiques, sociaux et environnementaux.
Si des entreprises prennent en charge l’intérêt général, quelles missions demeurent pour l’Etat et le service public ?
Dans mon esprit, ces entreprises d’intérêt général ne viennent pas en substitution à l’Etat ou aux entreprises lucratives mais en complémentarité.
Le service public se définit par les fonctions régaliennes. Elles doivent être assurées par l’Etat pour garantir une indépendance. C’est la loi qui doit garantir le périmètre du régalien, le reste doit être délégué aux entreprises d’intérêt général. Les pouvoirs publics doivent accepter de concéder une partie de leur rôle. La fonction publique est trop rigide pour prendre en compte rapidement les évolutions, les entreprises sont plus à même de le faire. Est-il normal que les jardiniers dans les collectivités soient fonctionnaires ?
L’exemple de la Mairie de Paris est intéressant, la décision a été prise de confier à une société privée l’établissement des contraventions avec un système automatisé. C’est une évolution positive : la collecte sera renforcée, le coût de collecte diminué et les agents pourront être redéployés vers d’autres fonctions plus épanouissantes.
Dans cette évolution de transfert au privé de certaines missions, comment assurer un rapport de force équilibré entre les entreprises et l’Etat ?
L’entreprise a un mode de régulation simple : ce sont ses clients qui la régulent. Si les clients ne sont plus satisfaits, ils peuvent choisir de ne plus s’approvisionner auprès d’elle et c’est ce qui les incite à évoluer ou ce qui fait émerger de nouvelles entreprises qui apportent une réponse plus efficace.
A ce titre, l’Etat doit devenir un meilleur client, exercer plus de pression, notamment en s’assurant d’un niveau de concurrence suffisant. Egalement, en tant que client, l’Etat doit pousser à la réalisation de solutions bénéfiques sur toute la chaîne. Les critères de choix des prestataires sont souvent préjudiciables à l’intérêt général. Comment imaginer qu’on va disposer de services positifs sur toute la chaîne si on établit le prix comme critère principal de choix. En poussant les entreprises à diminuer leur prix pour obtenir le marché, l’Etat les contraint à mettre en œuvre des solutions contraires à l’intérêt général. Par exemple détériorer les conditions de travail de leurs salariés ou utiliser des produits dont l’impact environnemental est élevé. Nous plaidons pour que l’Etat inclue des critères environnementaux et sociaux dans ses critères de choix.
Egalement, l’Etat doit s’assurer qu’il ne confie pas uniquement les parts d’activité rentables à des entreprises et laisser ainsi au secteur associatif les parts les moins rentables. L’exemple de l’aide à domicile est éloquent. En 10 ans les associations ont totalement disparu de ce secteur, il a été totalement pris en main par le secteur privé lucratif. Les entreprises ont commencé à s’établir sur ce marché en bénéficiant de conventions collectives avantageuses par rapport à celles des associations qui leur permettait d’avoir un avantage sur les coûts. Les entreprises ont été ensuite favorisées par rapport aux associations avec le CICE qui diminue les charges pour les entreprises mais pas pour les associations. Les structures lucratives se sont concentrées sur les zones rentables et ont laissé les zones les plus difficiles (souvent les zones moins denses) aux associations. On arrive donc à une situation où les associations doivent gérer les parts les plus couteuses avec les coûts les plus élevés alors que les entreprises disposent d’un avantage sur les coûts en se concentrant sur les zones les plus rentables. Si on ajoute à cela que certaines de ces structures lucratives sont détenues par des investisseurs financiers, on comprend bien que ces entreprises ne prendront pas en charge l’intérêt général sans contrainte.
Enfin, la régulation joue un rôle important pour assurer un équilibre entre les entreprises d’une part et entre les entreprises et les Etats d’autre part en luttant contre les ententes et en favorisant la concurrence. A ce titre l’Europe est la bonne échelle de régulation.
Le groupe SOS procède beaucoup par expérimentation, que vous ont-elles appris ? Comment expérimenter productivement ?
D’abord, les choix institutionnels aident. Dans le cas du groupe SOS, nous pouvons librement allouer des ressources à l’expérimentation, nous n’avons pas d’actionnaire qui exige de dividendes ou qui nous presse sur la rentabilité globale du groupe.
Ensuite, il faut pouvoir donner du temps au temps. Nous avons mis 10 ans à équilibrer nos magasins de commerce équitable. Pendant 10 ans nous avons essuyé des pertes et par expérimentations successives nous sommes parvenus à construire un modèle qui est équilibré aujourd’hui, nous sommes en train de le développer. Le temps est un luxe que beaucoup de patrons d’entreprises privées lucratives n’ont pas.
La vision stratégique fait partie des idées que je combats et qui bloque les expérimentations. Qui peut dire ce qu’il fera dans 5 ans ? Qui même aurait intérêt à le faire dans un contexte d’évolution si rapide ? Moi je ne sais pas prévoir ou décider où nous serons dans 5 ans. Par contre je sais m’adapter. A la vision et l’intelligence, je préfère le pragmatisme et le courage.
Enfin, le management compte énormément. Il y quelques années, j’ai fait une erreur : créer en central un département recherche et développement. J’avais agis par mimétisme en créant ce département et j’y ai mis fin au bout d’un an : les quelques idées qui avaient été produites étaient soit irréalisables, soit déjà réalisées à petite échelle dans l’un de nos établissements. Aujourd’hui nous avons un dispositif d’innovation décentralisé : chaque année, chacun de nos 405 établissements doit réfléchir à l’amélioration de ses résultats économiques, en termes d’impact et de service aux usagers. C’est plus long et cela mobilise plus d’énergie mais les résultats sont bien plus tangibles : les idées sont plus pertinentes et elles sont réalisées plus facilement. L’innovation ne doit pas venir du haut mais de chacun de nos établissements.
Pour assurer la prise en compte de l’intérêt général, vous plaidez pour un nouveau type de gouvernance : plus inclusive (les clients, les usagers, les salariés mais aussi les apporteurs de fonds et la société civile) est-ce le dirigeant qui arbitre les conflits entre ces intérêts divergents ?
Il faut dépasser la vision romantique du leader. Le dirigeant peut être avantageusement remplacé par un collectif. C’est ce que nous sommes en train de préparer pour le groupe SOS, une direction collégiale.
Ce nouveau type de gouvernance fait la part belle au conflit, la gestion par consensus a-t-elle échoué ?
Je suis pour la création de conflits permanents. Pour avancer et assurer la prise en compte par l’entreprise de l’intérêt général il faut reconnaître que les intérêts des différentes parties prenantes sont parfois divergents et souvent différents. La résolution du conflit passe par l’acceptation du conflit et l’institutionnalisation de contrepouvoirs. Sans ces contrepouvoirs l’organisation fonctionne pour elle même, s’éloigne de ses buts et encore plus de l’intérêt général. C’est pour cela que l’employeur doit se faire l’écho des usagers, des bénéficiaires, pas des salariés. Dans une structure de soin, si personne ne se fait l’écho des bénéficiaires on en vient à avancer les dîners à 18h pour que les salariés puissent rentrer chez eux suffisamment tôt.
L’enjeu est de parvenir à construire une gouvernance où chaque partie prenante est représentée, où les conflits sont évoqués puis résolus collectivement, c’est ainsi qu’on garantit la poursuite de l’intérêt général.